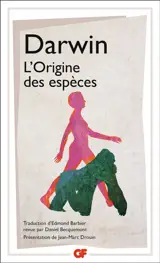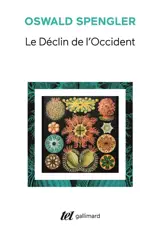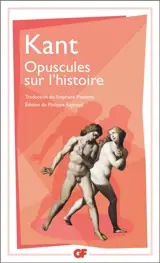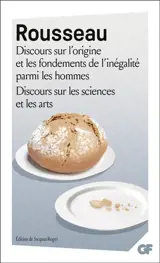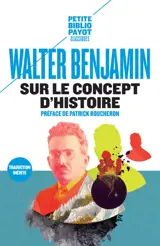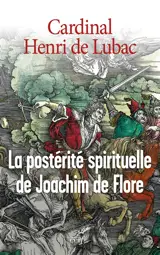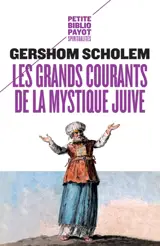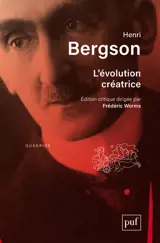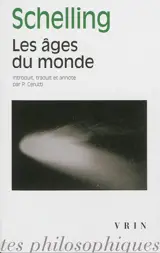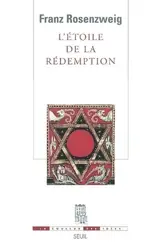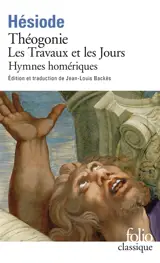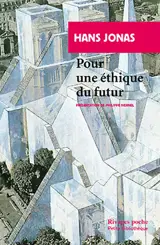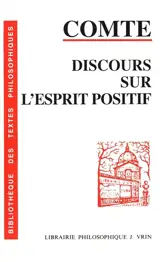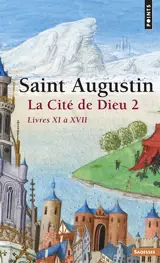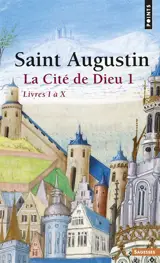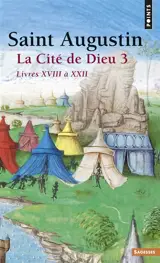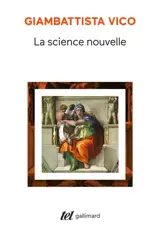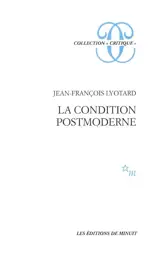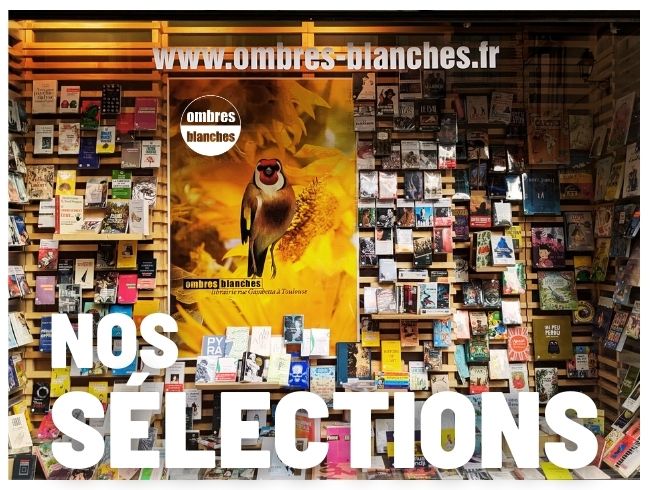
Philosophie du temps et du progrès
La notion de progrès, littéralement « marche en avant », désigne pour un individu donné, une société, voire pour l’humanité toute entière un processus cumulatif tendant vers un plus grand épanouissement, une plus grande perfection, un plus grand bien. Elle s’articule à une conception du temps au sein de laquelle les actions humaines ne s’inscrivent pas en cycle perpétuel ni en un affaissement et un déclin graduel, comme dans le mythe de l’âge d’or ou du paradis perdu qui voit dans le temps actuel une réalité en défaut par rapport à une plénitude passée. Et s’il semble que les textes bibliques puis l’essor du christianisme à Rome et en Occident ont pu ouvrir cette compréhension d’un temps linéaire où l’humanité s’avançait vers un horizon plus favorable, ce n’est qu’avec la modernité et particulièrement au XIXe siècle que le progrès est devenu l’un des concepts majeurs pour comprendre le développement de l’histoire humaine. Pour autant, s’il paraît difficile de nier que les sciences et les techniques aient progressé de manière impressionnante, les guerres du XXe siècle et d’aujourd’hui, la violence extrême faite à la nature annonçant des bouleversements inouïs, la croissance des inégalités, des injustices, des mésententes et des peurs contribuent à interroger la pertinence de la notion pour comprendre le déploiement de notre histoire.